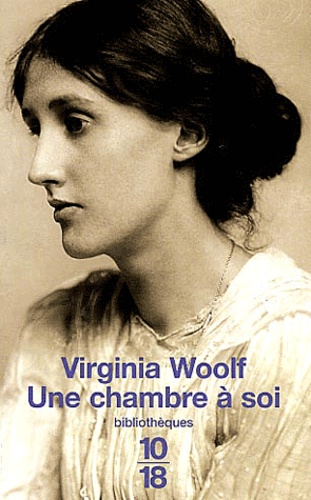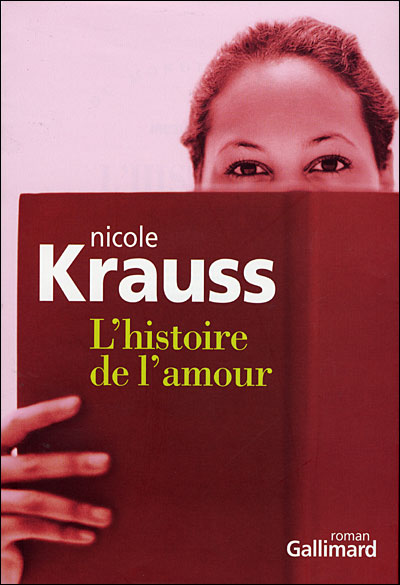La Femme de l’Allemand, Marie SIZUN
La Femme de l’Allemand, Marie SIZUNUn roman d’apprentissage sur le lien mère-fille à une époque où
pour ne pas châtier les coupables,
on maltraitait des filles.
On allait même jusqu’à les tondre*
Marion vit avec Fanny, sa mère, dans le Paris de l’après-guerre. Elles sont tout l’une pour l’autre. Fanny a quitté sa famille qui ne veut plus la recevoir car durant l’occupation elle a vécu une relation avec un soldat allemand. De cette union cachée et honteuse est née Marion. Elle apprend peu à peu, par la bouche de sa mère, ses origines. Pas de nom, peu d’éléments de l’histoire, juste l’idée que son père est l’Allemand, disparu quelque part en Russie après avoir quitté la France. Fanny est joyeuse, fantasque, un peu marginale ; une mère différente mais que Marion, Funny comme l’appelle Fanny, adore. Seules contre le monde, ou presque.
Ce que sa mère a enduré à la Libération, Marion ne peut que le deviner. Mais le comportement de Fanny se met à changer et à inquiéter. Car cette mère est folle, comme on le dit alors. Et de crises en crises, Marion passe d’un amour absolu à la crainte, la honte et finalement la haine.
Le portrait de cette jeune fille est particulièrement juste et Marie SIZUN rend bien compte de l’évolution et de la dégradation progressive du lien qui unit les deux personnages, rongé très par la culpabilité et les non-dits. L’adolescente se construit une histoire et une identité à travers celles de sa mère et tente de s’arracher, parfois avec violence, à l’emprise tentaculaire de Fanny, à la fois dans la fidélité et la trahison. Un apprentissage douloureux dont le roman s’empare de manière intelligente.
Mais à côté de ce thème fort et cette histoire assez prenante, il y a l’écriture qui, souvent, lasse. Une narration à la deuxième personne qui a vite fait d’énerver et des effets stylistiques un peu fabriqués (phrases à l’infinitif, répétitions, …). Dommage.
D'autres avis chez BOB.
* Paul ELUARD, "Comprenne qui voudra" in Au rendez-vous allemand (1944)